| |
Actualités
de l'IMV
François rejoint François-Marie
Voltaire
nous écrit
Le taureau blanc
Clin
d'oeil
En marge de l'Egypte des Lumières : Clin d'oeil à ...
A propos
de ...
De la « bibliothèque patriarcale » à la « bibliothèque impériale » - Grimm...
Nouvelles
du XVIIIème siècle
Un été chez Voltaire de Jacques-Pierre Amette
Liens
2007 : quelles bibliothèques numériques ?
Tout
le numéro en pdf 
inscrivez-vous
à la
Gazette des Délices |
|
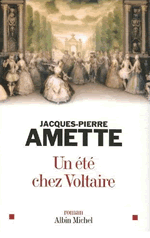
C’est le 7 janvier dernier qu’est paru, aux éditions Albin Michel, un roman signé Jacques-Pierre Amette et intitulé Un été chez Voltaire.
Baptisé par son auteur « comédie érotique au château de Ferney pendant l’été 1761 », il relate les deux mois que passent à Ferney trois personnages singuliers : Zanetta Obozzi, comédienne napolitaine, Gabriella Capacelli, tout droit issue du théâtre des Italiens, à Paris, et enfin le comte de Fleckenstein, envoyé spécial (mais secret) de Frédéric II. Ajoutez à cela une voyante, Gisèle, un abbé de Pors-Even et un graveur-dessinateur, et vous aurez réuni tous les ingrédients de cette immangeable salade.
L’auteur s’explique sur ses intentions dans une interview publiée sur le web, à http://amette.free.fr/ Il ne faut pour rien au monde manquer ce morceau d’anthologie. On y apprend que Mahomet est une pièce médiocre « où Voltaire imite mal son auteur préféré, Corneille ». Jacques-Pierre Amette s’intéresse d’ailleurs « à l’extinction de ce genre : la tragédie ». En effet, nous dit-il, le public « cultivé », en 1761, « préfère Goldoni et ses charmantes vénitiennes ».
Or nous savons que rien n’est plus faux. Plusieurs études très pénétrantes ont été publiées sur ce sujet ces quinze dernières années. Elles montrent que la tragédie, loin d’être un genre moribond, était au contraire en pleine forme dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle. Que penser du Siège de Calais, de Du Belloy (1765), et du Charles IX de Marie-Joseph Chénier (1789), deux des plus grands succès de cette période ? Dira-t-on, pour se disculper, que c’étaient de mauvaises tragédies ? Le public, trop nombreux pour ne pas être inculte, ne pouvait sans doute en percevoir la médiocrité...
Mais revenons au roman. Outre les personnages cités ci-dessus, on trouve… Jean-Jacques Rousseau. On le rencontre même dès l’exergue, où la sensibilité de ses personnages ne peut être, selon Jacques-Pierre Amette, qu’« encore classique ou déjà rousseauiste ». Nous frémissons de crainte. Et nos craintes, hélas, mille fois hélas, sont confirmées dans les pages qui suivent. Voltaire évoque ainsi Jean-Jacques : « Regardez autour de vous : à quelques kilomètres d’ici, à Genève, ce Rousseau écume de rage contre nous… » Or non seulement Rousseau n’écumait de rage contre personne, mais il pouvait difficilement le faire à Genève, qu’il avait quittée en octobre 1754, et qu’il ne reverra jamais.
Ce sont là, m’objectera-t-on, pures chicaneries. Après tout, qu’importent ces détails de spécialiste à un romancier ? La fiction ne peut-elle s’autoriser quelques licences ?
Bien loin de nous l’idée de contester à Jacques-Pierre Amette le droit de travestir la réalité, de créer ses propres personnages, de les inviter à Ferney, de les y faire rencontrer certain vieillard, voire de projeter sur toute cette assemblée ses propres fantasmes : le tout est que cet exercice se limite à ce qu’il est (un très mauvais roman) et ne prenne les formes d’une leçon de littérature.
Reste l’écriture, absolument lamentable. L’auteur a beau préciser qu’il s’est « efforcé de faire parler le philosophe de Ferney avec la vivacité de ton qu’il a employée avec ses correspondants », c’est cet effort, précisément, qui le trahit. Il nous dit aussi avoir cité Voltaire –et on le croit : mais peut-on extraire telle citation, telle pointe en oubliant le contexte qui leur donne tout leur sel ? Autant montrer deux yeux exorbités et sanguinolents sur une table d’opération en prétendant qu’il s’agit des plus beaux yeux du monde.
Inconsistantes lapalissades (« Notre Voltaire condamne les sottises des fanatismes, mais il aime Dieu. Il pense également que si Dieu n’existait pas il faudrait l’inventer »), expressions ternes (« L’abbé de Pors-Even, qui avait l’air triste comme un vaisseau sans voile »), répétition des mêmes traits d’esprit, ou soi-disant tels, toujours teintés d’un vague érotisme (« Ouvrez la serviette et votre lit », « Ouvre-lui ton lit », ) dialogues ennuyeux à l’extrême (cf. l’échange entre Voltaire et sa voyante), contrevérités flagrantes (sur Rousseau, sur le théâtre de l’époque, sur Mahomet, etc.) : rien ne nous est épargné. Absolument rien.
Mais le pire, et ce qu’on pardonnera difficilement à l’auteur, c’est d’avoir su rendre Voltaire ennuyeux. Un souvenir nous reste, quand on ferme le livre. Un seul. C’est celui d’un dialogue, en italiques, dans un des derniers chapitres. Il y est question d’une scène, qui vient d’être jouée : « Non, tout le monde riait ! Non, tout le monde s’emmerdait ! »
Avec Un été chez Voltaire, il n’y a vraiment pas de quoi rire. Pour le reste…

|
|